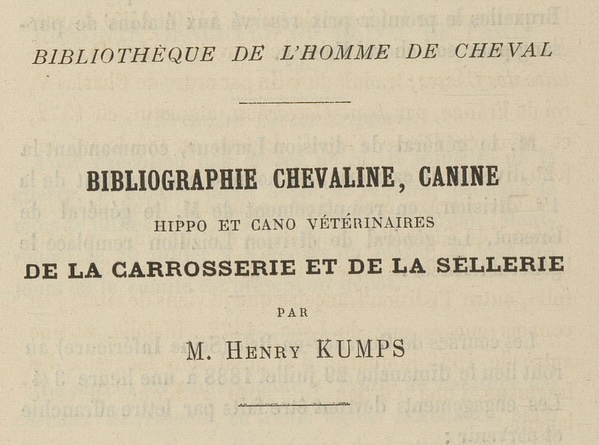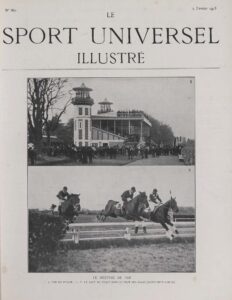Pierre Jonquères d’Oriola
Pierre Jonquères d’Oriola : « Je préfère de beaucoup avoir en main une cravache qu’un stylo ».
Une étude commentée sur Pierre Jonquères d’Oriola pour La Bibliothèque Mondiale du Cheval ?
Mais en quel honneur ? À quel titre ?
Pas celui d’un livre qu’il aurait écrit ! L’intéressé n’en a commis aucun — ou presque —, laissant ses admirateurs, journalistes ou écrivains, le faire : à chacun son métier !
Le sien ? C’était accessoirement viticulteur sur ses terres du Roussillon. Car l’autre, pratiqué avec assiduité depuis la prime enfance, c’était celui de cavalier de saut d’obstacles — de jumping —. Une carrière de quarante années commençant juste après la guerre avec au bout du compte deux médailles d’or olympique (Helsinki 1952 et Tokyo 1964) et un titre de champion du monde (Buenos Aires 1966). Pierre Jonquères d’Oriola est, à ce jour encore, titulaire d’un palmarès inégalé.
Décédé en 2011, à l’âge de 91 ans, il aurait eu cette année cent ans. N’était-ce pas un premier argument pour revisiter le parcours de ce champion hors norme ?
Le second étant que la deuxième médaille olympique du Catalan fut décrochée contre toute attente à Tokyo, en 1964. Or, sauf à ce que la pandémie du Coronavirus qui affecte la planète en ce printemps 2020, contraigne les organisateurs à leur report, les JO de Tokyo 2020, programmés du 20 juillet au 5 août, tombaient à pic pour commémorer l’exploit, 56 ans après.
La troisième raison, c’est que, en cette période de gel de toute activité sportive, équitation incluse, oser une étude commentée sur un champion pour La Bibliothèque Mondiale du Cheval, ouvrir une page sports équestres en cet été 2020, accessible à tous les équitants de France et au-delà, nous apparaissait comme une opportunité à ne pas manquer.
Enfin, et pour conclure « oser » cette étude, pour ceux qui l’ont vu monter, n’est-ce pas du pur d’Oriola dans le texte !
Par Xavier Libbrecht

J’ai conservé mes agendas. Depuis quarante ans. Et, dans le millésimé 1999, à la date du jeudi 28 octobre j’y lis Orly-Perpignan 15.05… Puis Hôtel Méditerranée, 62 bis avenue Charles de Gaulle.
Perpignan, d’Oriola… Pierrot… Mais oui, c’était ça ! Cet aller et retour prévu en fin de journée, avec au menu l’interview du double champion olympique.
Pourquoi cette année-là ? Parce que Pierre Jonquères d’Oriola qui allait fêter son quatre-vingtième anniversaire le 1 er février suivant (1920), avait été désigné par le comité de rédaction de L’Éperon comme, non seulement le champion, mais « La personnalité française équestre du XXe siècle», qui allait s’achever.
Sur la « Une » du dernier numéro de l’année, un numéro double, un numéro charnière daté décembre 1999-janvier 2000, ce titre sans ambages « La légende du siècle ».
Au téléphone, lors de la prise de rendez-vous, Pierrot qui me tutoyait depuis toujours, avec cet accent inimitable du sud-ouest, avait proposé de passer me prendre à l’aéroport puis de dîner et de loger chez lui à Corneilla-del-Vercol. J’avais poliment refusé. Pour deux raisons, toutes professionnelles.
La première c’est que j’avais des articles sur le feu, et que j’avais prévu d’y travailler dans ma chambre d’hôtel, de dîner léger et de me coucher tôt. La seconde, que par principe, habitude ou tout simplement souci d’efficacité vérifié au fil des années, je préfère attaquer tout sujet important (article, interview, problème à solutionner), le matin.
D’Oriola avait insisté. J’avais résisté.
Il faisait horriblement chaud en cette fin octobre, à Perpignan.
Il devait être environ 19 heures. Je m’étais mis à l’aise, soit en caleçon, dans ma petite chambre et je tapais à l’envi sur le clavier de mon ordinateur quand le téléphone sonna.
– C’est Pierrot ! Tu as bien voyagé ? Je suis en bas. Je t’attends !
– Mais Pierrot, je t’avais dit que…
– Je t’attends !
– Pierrot…
– Oui, je suis mal garé…
– Pierrot…
– Je t’attends.
Mon sang n’a fait qu’un tour ! Qu’il attende ! D’Oriola ou pas d’Oriola, qu’il attende ! Non, mais ça allait ! Ou bien, plutôt, ça n’allait pas du tout. À quarante-sept ans, je n’avais pas tellement l’habitude de me faire dicter ma conduite.
Dix minutes plus tard le téléphone sonnait à nouveau.
– OK. Encore cinq minutes Pierrot. Je boucle mon sac, je descends et je règle la note.
La poignée de main était ferme et juste. Le sourire un brin taquin mais bienveillant.
Il était content de son tour, comme un gamin, le grand, l’illustre, Pierre Jonquères d’Oriola.
– Ça n’a pas été très compliqué. J’ai appelé ton assistante à Paris et elle m’a donné l’adresse de l’hôtel. Allez, monte !
La voiture était garée à deux pas de l’entrée de l’hôtel et de trois quarts, soit un quart sur le trottoir. Un coupé sport, bas de caisse. Je ne me souviens plus de la marque, japonaise je crois. Une grosse cylindrée.
Pierrot monta côté rue et fut prestement assis. Encore bien souple l’octogénaire. À l’époque la ceinture c’était encore… Plus ou moins superflu !
Il fit ronfler le moteur et écrasa l’accélérateur dès la sortie de la ville. Fi des limitations de vitesse, un vrai train de barrage au chronomètre. Pour être honnête, champion olympique ou pas, je lui exprimais ma réserve.
De mémoire, sa réponse fut de cette veine …
– Je roule chaque année de Corneilla vers le jumping de Bordeaux dont je ne rate aucune édition, d’une traite. Paris-Porte de Versailles ou Fontainebleau, aussi, si j’en ai envie.
En moins de temps pour le dire, nous étions arrivés à la propriété située à une bonne dizaine de kilomètres du sud de la ville.
Le dîner fut servi dans la grande salle à manger de la demeure familiale.
Seul avec Pierre et Renata, sa deuxième épouse, le dîner fut l’occasion de se remémorer les souvenirs, d’échanger en toute liberté. Pierrot était homme d’opinion. Il ne se cachait pas derrière son petit doigt pour exprimer sa pensée, comme il était capable de s’interdire de se prononcer ou de juger lorsqu’il n’avait pas la connaissance du sujet.
Exceptionnel.
Comme l’était la très longue interview, publiée dans le numéro 186 évoqué plus haut, qui résultait d’un travail de journaliste. Si j’en fais état ici, dans cette étude commentée pour La Bibliothèque Mondiale du Cheval, c’est que Pierre Jonquères d’Oriola, à la différence d’autres champions de jumping, à commencer par Jean d’Orgeix avec lequel il a fait si souvent équipe, disparu accidentellement en 2006, n’a pas commis grande littérature. Une évidente retenue, réserve qui relevait tant de la modestie que, tout paradoxal qu’il en soit, de l’orgueil : sous-entendu « s’ils ne le mesurent pas ». Ce côté Tabarly évoqué en fin d’article… Nous y reviendrons.
Le champion a aussi résisté à l’idée ou l’envie de publier quelconque traité ou cours d’équitation qui se seraient probablement vendus comme des petits pains vu sa notoriété ! Pas de leçons ! Pas de bouquins ou presque ! Pas de produits dérivés ! C’est à cheval que ça se passe ou parce ce qu’on lui demande de s’exprimer !
Au total, la bibliographie de Pierre Jonquères d’Oriola se résume donc à quelques interviews, une correspondance avec les journaux choisis, quand il était d’humeur (c’est-à-dire de mauvaise humeur) et, au bout du compte quatre livres et quelques brochures.
Les premiers ouvrages consacrés au Catalan datent du retour de Tokyo (1965).
Fernand Albaret, le journaliste de confiance.
Ils sont tous deux signés par Fernand Albaret, grand reporter à l’Équipe de 1946 à 1970. Un personnage (voir son interview en 2002) et une chouette plume qui traîna son talent aux quatre coins de la planète sport. Il traitait aussi bien de vélo que de foot, de tennis que de rugby ou d’automobile ou enfin d’escrime et d’équitation, les deux disciplines étant grandes pourvoyeuses de médailles olympiques grâce à une et même famille du Roussillon : les cousins Christian et Pierre d’Oriola, l’un bretteur (fleuret) et l’autre cavalier. Il ne manqua pas d’ailleurs de signer un premier livre sur lequel nous ne nous étendrons pas, sauf pour dire qu’il témoigne bien de l’ambiance sportive (l’escrime et le sport équestre en particulier) et sociale hexagonale, des années d’après-guerre (1950-1970) intitulé : Les d’Oriola et les vendanges olympiques publié aux éditions de La Table Ronde en 1965 dans la Collection L’Ordre du Jour (1 vol in-8, 210 pp., broché, couverture illustrée, achevé d’imprimer le 1 er avril 1965).
Celui qui nous intéressera dans cette étude commentée, comme les autres qui suivront ici, concerne uniquement et entièrement, le cavalier « achevé d’imprimer », lui, le 25 juin.
Fernand Albaret avait la plume « romanesque », qui correspondait parfaitement à l’attente de l’époque. Au lendemain de la guerre la télé n’existait pas. Seule la radio qui crépitait dans les foyers, faisait état de l’avancement de la performance que ce soit pour le Tour de France, le football ou le rugby. Il restait donc aux journalistes de la presse écrite, un « boulevard » pour faire revivre, une fois le résultat connu, l’épopée sportive. Il fallait conter l’exploit, faire rêver, créer des légendes.
De tous temps, quand l’Équipe s’appelait encore l’Auto , au début du siècle passé, de belles plumes, à l’instar de celle de Louis Hémon s’y lâchaient déjà ! Sous Jacques Godet le patron du premier quotidien sportif qu’il dirigea de 1946 à 1984, la liste s’allongea, ainsi Antoine Blondin par exemple, y signa plus de 700 chroniques. L’une d’elle, intitulée « Dix de Der », écrite au soir de l’exploit de Tokyo, reprise dans une compilation titrée L’ironie du Sport publiée chez François Bourin (1988, in-8° broché de 450 pages) est un bel exemple du genre qui, selon la fille de Pierrot, Isabelle Jonquères d’Oriola était l’une de celles que son père et elle-même préféraient.
Un éloge de Blondin, l’un des trois hussards de la littérature des années d’après-guerre avec Roger Nimier et Jacques Laurent, les valait tous. Qu’on lise ainsi, dans un chapitre du livre intitulé L’équipe raconte L’Équipe (ouvrage collectif de l’association Les anciens de l’Équipe, NDLR ) , le portrait que Denis Lalanne, une autre plume du journal, chantre du rugby, du tennis, du golf et de la pelote basque (mais si !) fit de l’impertinent auteur d’ Un singe en hiver :
« La contribution d’un Louis Hémon, d’un Jacques Perret et surtout celle d’Antoine Blondin contribua au rayonnement du journal, voilà de quoi clouer le bec à une certaine intelligentsia parisienne (…) ». Dans la foulée de cet article, Benoît Heimermann liste les plumes qui ont truffé les colonnes du quotidien : « Un Pierre Mac Orlan ou un Tristan Bernard s’en donnèrent à cœur joie. Et bien d’autres dans leur sillage (…) ».
Cette digression littéraire pour dire que, même si Fernand Albaret ne revendiqua jamais le statut d’écrivain, les nombreux ouvrages qu’il commit sur les sports qu’il a suivis toute sa carrière, sans en être forcément un éminent spécialiste, furent toujours d’une belle facture, à l’instar de celui consacré, en 1965 à Jonquères. Le titre de l’ouvrage ? Pierre Jonquères d’Oriola ! Tout sec ! Il est probable que, dans l’esprit de Fernand Albaret et de son éditeur, prénom et patronyme suffisaient pour « accrocher ». Pas besoin d’en rajouter, tout était alors dit ! L’éditeur justement ? La Librairie des Champs-Élysées, fondée par Albert Pigasse en 1925, pour populariser le livre d’aventure. Cet éditeur traversa presque le siècle (1887-1985). Il est plus connu pour avoir lancé la collection Le Masque (polars).
Le format et le papier « typaient » cette maison d’édition (rachetée par Stock au milieu des années 1960 puis par Hachette en 1971). Le cavalier et illustrateur, Yves Benoist-Gironière, l’affectionnait et le promouvait joyeusement à chaque nouveau titre : Conquête du cheval , Conquête du cavalier , Concours Hippique , À cheval Ma Mie , Cheval mon Cher Souci , Rêveries Équestres, etc…
On s’interroge encore aujourd’hui sur le choix (à moins qu’il ne s’agisse d’une commande) d’Albaret de publier « son » d’Oriola chez le dit éditeur, dans un format qui tient davantage de l’album que du livre. Précisons ici qu’au-delà d’Albert Pigasse, « les Pigasse » forment une sorte de dynastie de l’édition et de la presse. Albert Pigasse est le père de Jean-Paul Pigasse, qui dirigea la rédaction de l’Express, qui est lui-même est l’oncle de Mathieu Pigasse, banquier d’affaire investi dans la presse ( Le Monde , Les Inrockuptibles , Radio Nova , Huffington Post , etc…). Le frère de Matthieu, Nicolas, co-fonda le magazine Public et sa sœur, Virginie Pigasse, a travaillé au magazine Globe .
Enfin, Matthieu Pigasse est le fils de Jean-Daniel Pigasse, décédé en 2019, qui fut pendant de nombreuses années secrétaire général de La Manche Libre et attesta de son intérêt pour le monde du cheval lorsqu’il dirigea, quelques années durant, le mensuel Cheval Magazine lorsque ce dernier appartenait à Didier Rémon ( Réalités ) dans les années 1975-1978.
Un regard, une faconde, un style.
Le choix de La Librairie des Champs-Élysées donc ? Peut-être en raison de la place laissée à l’illustration. Car la photo, toute en noir et blanc — sauf la « Une » qui mérite le détour (d’Oriola le cavalier solitaire en selle au milieu de ses vignes) —, a la part belle.
Les clichés pris à Tokyo sont signés du photo-reporter de l’Équipe (encore !) Robert Legros. Jacques Barde a assuré un reportage sur place à Corneilla. Pour le reste ? Des photos d’archives, à commencer par celles du célèbre duo de l’Année Hippique , Oscar Cornaz et Jean Bridel, avec lequel d’Oriola correspondit d’ailleurs au lendemain de son titre mondial en 1966 et quelques autres, probablement venues de collections plus anciennes (A. Durau et J. Dufau).
À noter, enfin, de jolis petits « cabochons » au trait signés Paulette Lagosse.
L’ouvrage, une fois n’est pas coutume, commence par une lettre à l’auteur signée par le sujet du livre d’Albaret : P. J. O. en personne ! Une « incongruité » qui ne lui échappe pas puisque dès les premières lignes d’Oriola convient : « Vous m’avez demandé de préfacer votre livre et, résistant à votre amicale insistance, j’ai cru devoir refuser. N’y-a-t-il pas en effet quelque chose d’insolite à présenter un ouvrage dont on est soi-même le héros ? De plus, vous le savez, et quoique m’en servant rarement, je préfère de beaucoup avoir en main une cravache qu’un stylo ».
Un préambule qu’il termine, histoire de revenir en selle après cette acrobatique politesse, par l’évocation de « l’émotion si profonde » qu’il a éprouvée en lisant l’ouvrage d’Albaret, laquelle émotion lui a intimé « de revenir sur ma décision première ». Libre donc l’auteur de faire l’usage qu’il souhaite de cette lettre, qui terminera… en préface !
Restent les treize chapitres de l’ouvrage découpés comme un scénario.
À tout seigneur, tout honneur. Tout commence par le cheval, le partenaire de l’exploit de Tokyo sans lequel rien n’eût été possible : la présentation de Lutteur B et de ses origines, le pur sang Furioso. L’un des étalons (pur sang) basé au Haras national du Pin dans les années 1950-1960 dont l’influence dans le studbook du Selle Français fut déterminante.
Et l’ouvrage se termine, 140 pages plus loin, par le portrait d’un homme de quarante-cinq ans, en pleine force de l’âge qui a déjà beaucoup vendangé, au propre comme au figuré.
À l’instar d’un parcours de jumping, on y saute, chapitre après chapitre, les obstacles d’une vie de sportif « amateur », qui ne saurait se limiter à l’exercice de sa discipline.
On a ainsi aimé les titres comme : « l’étrier et la charrue », « un travailleur d’instinct », « le champion de la simplicité ».
On fut étonné par celui intitulé « le Prince Charmant ». Nous sommes en l’an 1946. Juste après-guerre. Deux « grands » emmènent une petite de concours en concours… Une « petite » d’à peine 16 ans, à savoir Michèle Cancre nous apprend Albaret. Pas n’importe qui ! « Ce qu’a fait cette blondinette d’apparence fragile, aucune femme au monde ne l’a même tenté. D’abord championne de France féminine de jumping et gagnante de maintes épreuves internationales mixtes, elle s’est ensuite bagarrée avec les hommes dans de sensationnelles épreuves de stock-cars avant d’effectuer trois traversées automobiles du Sahara, aller et retour, et de remporter trois fois la Coupe des Dames en compagnie d’Annie Soisbault dans le tour de France automobile. Une relation dite « en tout bien tout honneur ». D’ailleurs, c’est finalement Jean d’Orgeix qu’épousa Michèle Cancre en 1952, et ce même si la « Une » du numéro 62 de L’Éperon de 1949 pouvait laisser penser le contraire. Faut-il préciser ici que le rédacteur en chef de ce premier numéro à user de la quadrichromie en « Une » n’était autre que … Jean d’Orgeix qui relança à cette occasion le magazine en perte de vitesse. Un engagement dans la presse, qui, comme bien d’autres passions, ne dura pas longtemps; pas plus que son mariage avec Michèle Cancre dont il divorça quelques années plus tard.
Assurément, comme d’Oriola à cheval, Albaret c’était un regard, une faconde, un style. Tous deux, originaires du Sud-Ouest, les deux hommes n’auraient pas pu ne pas se rencontrer et s’entendre !
Signé d’Oriola ce livre-là. Certes…
Les clameurs de Mai 1968 viennent à peine de s’estomper que, tout chaud et selon la formule « achevé d’imprimer le 11 juin 1968 par l’imprimerie Hérissey à Évreux », soit trois ans après le premier livre de Fernand Albaret, sort, aux éditions Raoul Solar, À cheval sur cinq olympiades, signé Pierre Jonquères d’Oriola. Un format de livre de poche ou à peu près, une couverture cartonnée et une jolie jaquette couleur : très commercial.
Un mot ici sur l’imprimeur. Parce que les frères Paul-Arnaud et Charles Hérissey, sixième génération aux commandes de cette grande maison dont la première « machine à feuilles » fut installée à Évreux en 1847, en ont imprimés des livres et des magazines sur le cheval ! N’étaient-ils pas eux-mêmes passionnés d’équitation et surtout de vénerie ?
En particulier, Charles qui, tandis que son frère tenait ferme les rênes de l’usine, trouvait le temps d’esquisser quelques croquis, de jouer de l’aquarelle et de l’humour, pour pondre de joyeux et bien jolis albums préfacés par son ami Antoine Reille, fils du Baron Karl Reille (1886-1975), artiste peintre animalier français dont les aquarelles et gouaches cynégétiques, les scènes de chasse à courre et les représentations animalières sont des plus abouties. Ainsi : Le livre de chasse de Mr Prettywood (1987), Le Livre de chutes de Mr Prettywood (1994)…
À cheval sur cinq olympiades , imprimé chez Hérissey pour le compte des éditions Raoul Solar aurait donc été écrit par Pierre Jonquères en personne. C’est ce que la une du livre annonce, prétend… d’autant — on insiste —, qu’il est signé officiellement du nom du champion et qu’il est le seul dans ce cas sur les quatre référencés. Interrogé sur le sujet d’Oriola n’aurait jamais démenti, sans pour autant jurer ! Et donc le doute persiste. Pour deux raisons. La première reste ce « billet » de Roger-Louis Thomas, éditeur et rédacteur en chef de l’Information Hippique dans le numéro daté juillet-aout 1968 numéro 134-135, soit après la sortie du bouquin. Dans la rubrique « Le Cheval et les livres », p. 46, on peut lire : « On trouve depuis peu en librairie le premier ouvrage où apparaît la signature de Pierre d’Oriola sur la ligne réservée à l’auteur. C’est évidemment un événement ! En effet, Monsieur d’Oriola ne nous a guère habitués jusqu’ici à fréquenter sa littérature personnelle mais plutôt celle des autres… À propos de lui. Et notre excellent ami Fernand Albaret en sait quelque chose. À ce point d’ailleurs qu’il ne nous étonnerait guère que l’écrivain sportif (et brillant journaliste, comme l’on sait) ne soit allé de temps à autre ces derniers mois vers ce Roussillon qui les rapproche pour inciter notre champion à noircir des feuillets… Pourquoi pas ? D’autant plus que les feuillets en question sont intéressants à lire. Une personnalité (secrète) comme l’est celle de Pierre d’Oriola ne se dévoile jamais d’un seul coup. Quelques détails de sa vie de cavalier et d’homme de cheval nous étaient encore inconnus ». Pour ceux qui ont connu Roger-Louis Thomas, aussi bon observateur de la chose équestre en cette deuxième moitié du XXe siècle qu’il était maître dans l’art de la circonvolution, le sous-entendu est clair. Albaret, une fois de plus, a sévi ! Avec une écriture bien différente, plus directe, plus nerveuse que pour son premier ouvrage. Il est dans la peau de d’Oriola. Osons affirmer : il fut, pour le moins, le demi-nègre de Pierrot. Lorsque dans sa chronique, RLT évoque « Quelques détails de sa vie de cavalier et d’homme de cheval nous étaient encore inconnus », il s’agit à n’en point douter de la fin du livre où « l’auteur » se prête à un jeu de questions réponses ( À cheval sur cinq olympiade , p. 211). Avec qui ? Je vous le donne en mille : Fernand ! Avant la première question « J’ai bien voulu confier mes souvenirs à mon grand ami Fernand Albaret qui m’a vu gagner à Helsinki (1952), à Tokyo en 1964, à Buenos-Aires en 1967… Et perdre ailleurs ». L’interview a surtout trait à la vie du champion à la-dite époque, et à celle plus globale des sports équestres en France à quelques mois des J.O. de Mexico (octobre 1968) ou Jonquères qui allait monter Nagir (propriété de Philippe Jouy) n’allait pas obtenir cette fois le succès individuel escompté, mais contribuera malgré tout à la médaille d’argent par équipe pour la France (Janou Lefebvre et Marcel Rozier).
Cette dernière partie du livre, moins répétitive pour ceux qui avaient lu le premier « Jonquères d’Oriola », est illustrée de façon exclusive. Ainsi le propos induit de Roger-Louis Thomas s’explique par la découverte de plusieurs photos signées Alain Taïeb. Sur quatre des huit clichés du reportage « très Paris-Match », ce qui n’est pas vraiment le style de l’homme, Pierrot est en scène avec Renate Knobloch sa deuxième épouse (8 février 1966) et leur première petite fille Ghislaine qui sera suivie d’une autre sœur, Laurence.
Précisons que Pierre Jonquères d’Oriola avait épousé, le 1er décembre 1953, Jacqueline du Vignau avec laquelle il eut deux enfants, Pierre et Isabelle (Mme Jacques Mouton).
La deuxième raison pour laquelle nous pensons que l’ouvrage signé par Pierre Jonquères d’Oriola ne l’est probablement que très (très) peu, tient au fait qu’à plusieurs reprises il a expliqué que la chose écrite n’était pas son truc… Dans la lettre à l’auteur, Fernand Albaret, déjà évoquée plus haut : « (…), vous le savez, et quoique m’en servant rarement, je préfère de beaucoup avoir en main une cravache qu’un stylo ».
Un propos confirmé dans le dernier ouvrage consacré au champion (Équitation naturelle), signé par Elsa Romero et publié en 2008 aux Éditions Trabucaires sises à Canet, à deux pas de la plage de Saint-Cyprien où le cavalier aimait, déjà très jeune, piquer une tête dans la Méditerranée tout autant qu’il affectionna la pratique du vélo sur le tard.
Avec Elsa Romero, quelques dernières réflexions
On peut y lire en effet, p. 24, sur le besoin de communiquer tel que le fit toute sa vie son alter-ego, Jean d’Orgeix, auteur d’une flopée de livres et d’articles : « je n‘aurais jamais pu procéder ainsi. Il faut une grande rigueur pour se contraindre à ces rédactions et il faut également avoir un certain goût de l’exhibitionnisme des sentiments…Ce que je n’ai pas. Mes émotions, elles sont miennes, elles m’appartiennent, je me les suis gagnées, qu’il s’agisse de joies ou de peines. ».
Ce livre d’Elsa Romero est joliment titré : Équitation naturelle . Là encore, les amateurs de trucs et de recettes en seront pour leurs frais. L’ouvrage parle moins d’équitation (c’est-à-dire de l’art de monter à cheval), que de comportement, de vie, de bon sens pour conduire celle-ci à l’instar de son cheval. Malgré tous les efforts de l’auteure pour arracher quelque enseignement théorique, on y retrouve le « fond » de l’homme qui faisait, quarante ans plus tôt, la matière du livre d’Albaret. Mais la plume d’Elsa, est ici, disons plus moderne, plus « pratique ».
D’Oriola, de la même façon qu’il se vantait de pouvoir enfiler la même veste et la même culotte de cheval à quatre-vingts ans comme à trente, n’a jamais varié dans son mode de pensée tout au long de sa vie. Une ligne droite, comme un alignement de ceps de vigne. Avec l’âge, le sillon s’est même probablement creusé.
La première partie de l’ouvrage consiste en un nouveau rappel de la carrière du Catalan : famille, débuts et parcours de 7 à 57 ans… On y trouvera plus détaillés qu’ailleurs, toutefois, les récits de deux trois moments forts de la vie du champion comme sa non sélection aux Jeux de Londres en 1948 et l’échec par voie de conséquence de l’équipe de France : cette « ressaca » ou encore « borratxera » (cuite mémorable), la veille du dernier stage de sélection à Fontainebleau, qui fut la cause de son éviction de l’équipe. Au-delà de l’anecdote et de la franchise de Pierrot qui reconnaît sa faute, s’amorce une réflexion sur la façon dont le champion envisage le principe même de la sélection d’une équipe.
Plus connu, mais raconté par l’intéressé l’incident qui a failli l’empêcher de prendre part au barrage du Grand Prix d’Helsinki en 1952 et donc d’y remporter sa première médaille d’or olympique, ne manque pas de sel. En selle sur Ali Baba, « je terminais la deuxième manche avec …0 points de pénalité. Sans faute ! Mission accomplie, me voilà donc premier ex-aequo avec l’Allemand Thiedemann, le Chilien Christi, l’Anglais White et le Brésilien Ménézès. Il y eut donc barrage… Auquel je faillis ne jamais participer !
Afin d’évacuer la pression et de me reconcentrer, j’étais sorti de l’enceinte du stade après la seconde manche. N’ayant pas mon laisser-passer, le service d’ordre me refusa l’entrée du stade. Il faut dire, à leur décharge, qu’en ce soir de cérémonie de clôture il régnait une importante confusion autour du stade. Je n’ai jamais été doué pour les négociations verbales, en revanche, bien qu’ayant délaissé la pratique du rugby depuis plusieurs années, j’avais conservé intacts mes talents de trois-quarts aile. Deux trois crochets et une barrière franchie dans un style impeccable et me voilà dans le stade ( …) Cet incident m’a mis dans une rage folle ». Pour le chef d’équipe, le colonel Cavaillé, voisin (Béziers) et ami de toujours de la famille qui connaît Pierrot depuis qu’il est enfant, cette colère est de bon aloi. Le tirage au sort veut que le Français soit le premier des cinq barragistes à s’élancer sur la piste. Alors, profitant de la circonstance et de l’humeur offensive de l’homme, la consigne est simple : « partir vite, continuer vite et finir vite ; couper le plus court possible et s’agiter pour accentuer l’impression de rapidité, ce qui devait inciter les adversaires à prendre tous les risques ». Le plan fonctionna à merveille. D’Oriola fut le seul sans faute !
D’Oriola est aussi capable d’autocritique. Les faits ? Nous sommes en 1972 à la veille des Jeux de Munich et il claque la porte de l’équipe de France.
En fait, la polémique avait commencé deux ans plus tôt, avant le championnat du Monde de La Baule, en 1970. Alors que Pomone B a pris le chemin de la retraite, d’Oriola ne trouve pas de remplaçant à la mesure de sa réputation et de son ambition. Il n’est pas remonté à son goût pour défendre son titre de Buenos-Aires (1966), en conçoit une vraie amertume et s’en épanche. La presse s’empare de ses critiques et l’on parle déjà, comme Roger-Louis Thomas la nomme dans l’ Information Hippique des mois de juillet-août 1970 (numéro 158, p. 8), de « l’affaire d’Oriola ».
Le début de la fin
Le ton se durcit en 1971. Parmi d’autres publications, Le Parisien Libéré du 17 mai, soit une semaine avant le CSIO de France qui se déroule cette année-là à Fontainebleau, sort un dossier de plusieurs pages sur le sujet sous la direction de Georges Pagnoud. Le dossier est très critique. On peut lire en titre : « Le scandale de l’équitation : 100 milliards dépensé par l’État en 25 ans pour des résultats dérisoires ». Les Haras nationaux, la Fédération sont sur la sellette. Et belle part est faite au propos de Pierre Jonquères d’Oriola qui comme le Colonel Jousseaume (plusieurs fois médaillés en dressage) sont « deux grands cavaliers qui ont payé de leur personne… et de leurs deniers ».
Les faits ? Sa monture d’alors est Tournebride, mais il ne la considère pas assez performante. Il veut « mieux ». La Fédération Française des Sports Équestres (FFSE) par l’entremise du DTN, le colonel Boyer, le lui promet. Il y croit et attend patiemment.
Mais le dénouement fatal aura lieu en 1972, sur le vieux terrain de concours hippique de Port-Blanc à Dinard ou Pierre Jonquères d’Oriola termine 20e du Grand Prix avec sa jument Tournebride qu’il considère depuis des mois déjà comme étant d’un niveau insuffisant pour lui. Quant au cheval, Moët et Chandon (ex Morning Light), acheté pour lui par la maison champenoise qui voyait là l’occasion de dorer son image, il sort d’une opération du dos.
En réalité, tout au long des mois qui ont précédé cette dernière étape de sélection avant Munich, d’Oriola a traîné des pieds en espérant ainsi décider les autorités à lui confier un certain Varin que monte le jeune commandant Pierre Durand. C’est ainsi, comme l’indique encore l’ Information Hippique de juillet 1972 numéro 181 p. 6, qu’il a quitté Aix-la-Chapelle pour rentrer « au bercail » le jeudi 6 juillet, en plein concours après une performance qu’il a considérée comme médiocre dans l’une des grosses épreuves (le Championnat d’Allemagne). Et il pousse le bouchon encore plus loin pour le dernier rendez-vous préolympique de la côte d’Émeraude comme le relate encore l’ Information Hippiqu e du mois d’août 1972 numéro 182 pp. 12-13, sous le titre « Décisions, espérances et … Remous préolympiques… ». En fait, la direction technique nationale l’a sélectionné, mais pas avec la monture qu’il espérait et que selon lui « on lui avait promis ». Ce sera la bonne Tournebride ou rien ! D‘Oriola, comme l’on dit aujourd’hui, « pète un câble », annonce qu’il rend Tournebride à son propriétaire et tourne …les talons.
À tort ? L’équipe de France ainsi sélectionnée « essuie un pénible échec » en terminant dixième par équipe tandis que Marcel Rozier et Sans Souci concluent en septième position en individuel. Pierre Jonquères d’Oriola avait-il pressenti cette déroute ? Son coup d’éclat à Dinard avait-il donc été tactique, prémédité ?
La réponse c’est Elsa Romero qui l’apporte 45 ans plus tard en page 40 « Jeux Olympiques de Munich 1972 : le rendez-vous manqué ».
Non, il n’a rien anticipé. Il regrette même son coup de sang ! « La Fédération m’avait promis un cheval qui ne m’a pas été confié. Tournebride était une bonne jument de Grand Prix, mais un peu juste pour espérer gagner l’or olympique. La Fédération m’avait donc promis un cheval militaire que je devais tester sur le concours de Dinard, quelques semaines avant les Jeux. Je me retrouve donc à Dinard, devant le box, en tenue, avec mes bottes, ma veste, ma bombe et ma selle sous le bras et voilà que ces Messieurs de la fédération me disent :
– Non, tu comprends, on ne peut pas te confier le cheval, il faut le laisser à son cavalier habituel, c’est un militaire et le cheval est aussi militaire, toi tu as déjà une bonne jument…
Le moins que je puisse dire, c’est que je n’ai pas apprécié !!! Je me suis contenté de leur dire :
– Au revoir, merci ! Vous m’aviez PROMIS ce cheval, si vous ne me le confiez pas il faudra vous passer de mes services pour ces Jeux… »
Et je suis reparti par où j’étais venu, ma selle sous le bras. Ils m’avaient PROMIS, ils me l’avaient PROMIS ! (…). Mais ils m’avaient promis Varin (c’est le nom du fameux cheval), ils ne me l’ont pas donné…au dernier moment…C’est pour cela que j’ai été furieux et que j’ai refusé la sélection avec Tournebride. C’est Hubert Parot (avec le cheval Tic NDLA) qui m’a remplacé. Aujourd’hui encore je regrette de m’être emporté… J’aurais dû aller aux Jeux… Même avec Tournebride… Je regrette… Même avec Tournebride j’aurais pu faire une place plus qu’honorable. Je le regrette, mais sur le moment j’ai laissé parler mon cœur, la Fédération m’avait PROMIS quelque chose et la promesse n’a pas été tenue, je n’ai pas accepté ».
C’est vrai, d’Oriola a joué, malgré lui, contre lui.
Peut-on en rester là aujourd’hui, à la simple explication de l’intéressé ? Ne pourrait-on y voir un « coup » politique, voire politicien des autorités de l’époque qui connaissaient bien leur d’Oriola ? Bref, un coup tordu ?
Pourquoi cette hypothèse ? Pourquoi, comme le dit une nouvelle fois l’éternel Fernand Albaret en conclusion de son article de Dinard (l’ Information Hippique août 1972, numéro 182 p. 12) aurait-on poussé d’Oriola à la faute ? Citons : « On a donc mis Jonquères d’Oriola dans une fausse position. Et il ne pouvait s’en sortir que par un coup d’éclat à la Catalane, ce qu’il a donc fait à Dinard ».
Pourquoi ? Parce que d’Oriola n’avait pas que des amis, qu’il fallait faire place aux jeunes, qu’il pouvait agacer, mais que personne ne se serait avisé à le lui dire en face. Fier, parfois hautain, il impressionnait. Mais surtout il avait un impact médiatique tel que de le prendre de face posait problème…
Parmi les attendus de l’époque apparaissait aussi le fait que le champion pouvait n’apparaître intéressé que par lui-même, par le besoin d’étoffer son palmarès par un nouveau titre olympique. Un triplé. Le Graal !
Alors « Les Messieurs », l’ont coincé. Albaret a raison.
Et de fait, ils ont fait mieux ou pire : ils ont mis un terme à l’ambition du champion.
Ce qu’Elsa Romero ne lui arrache-t-elle pas une page plus loin, quarante-cinq ans après ? « Après l’épisode de Dinard, la déception a été très forte. On peut dire que ce fut le début de la fin. »
Cette lucidité, cette honnêteté, au fond cette simplicité qui l’ont poussé à émettre ce regret — exprimé certes bien après les faits —, sont là encore, à nos yeux, la marque du champion. Alliées de l’ambition de celui qui, avant tout, est d’abord un compétiteur, ces qualités n’expliciteraient elles pas son parcours, sa réussite inégalée en saut d’obstacles, à ce jour ?
Un legs technique qui peut apparaître déconcertant…
C’est davantage cette personnalité du champion qui transparaît au travers des ouvrages, articles et correspondance analysés dans cette étude, que son legs technique ou théorique.
Attardons-nous encore.
Le premier vrai portrait du cavalier champion est à nos yeux signé du lieutenant-colonel Xavier Bizard dans les premières pages de l’ Année Hippique datée 1952-1953. Bizard a monté pour l’équipe de France de 1924 à 1936. Avec une 6e place aux J.O. de Berlin en 1936 (Bagatelle), 48 participations en Coupe des Nations pour la France, il est contemporain des Clavé, Cavaillé, Gudin de Vallerin etc… Bref, Bizard sait de quoi il parle et on aime lorsqu’il déclare à propos du jeune médaillé olympique : « Il est le contraire du fort en thème. Avec lui, pas d’idées préconçues. Il n’a pas appris dans les livres d’équitation, ni dans les manèges. Il est tout instinct et expérience. Pour lui, un cheval c’est comme une puce. Un animal qui saute. Il ne le conçoit pas autrement. »
Une façon déjà de dire qu’il y a peu à attendre en réalité de d’Oriola sur le plan technique. En 1952, à Helsinki, d’Oriola n’avait que trente-deux ans. On ne trouvera pas beaucoup mieux dans le genre, par la suite. Des petites phrases, ici ou là. Chez Albaret, en 1965, chapitre IX avec en titre « Le champion de la simplicité » : « Jonquères d’Oriola n’est pas le produit d’une école et il serait difficile de dire à qui il a emprunté son style. De l’imitation naît souvent la complication, paraît-il. Or s’il est une monte au monde qui n’est pas compliquée c’est bien celle du champion olympique. Il suffit pour en être informé d’écouter le général Christian de Castries, ex-recordman du monde de saut en hauteur (2,40 m avec Vol au Vent au Grand Palais en 1934), et de saut en largeur (7,60 m avec Tenace à Spa en 1935). « Quelle est la caractéristique du style de Jonquères ? Il monte simplement. En fait, l’équitation est un art simple. Elle ne procède d’aucun miracle, ni d’aucune sorcellerie mais de deux données de base : l’équilibre et l’impulsion. Quand on regarde monter Jonquères, et c’est pour ça qu’il est l’un des plus grands cavaliers du monde, je dirai même le grand cavalier tout court, on ne voit rien bouger. Pas d’action de jambes et de mains spectaculaires, ce qui ne veut pas dire qu’il ne fait rien, loin de là. Ce n’est pas de la dissimulation car il n’est pas possible de cacher quelque chose en pleine action, mais du dépouillé, en un mot de la simplicité. L’art du Catalan est de voir loin et de régler (le nombre de foulées avant l’obstacle NDLA) à grande distance. Au point qu’il n’intervient jamais au dernier moment sauf dans les cas désespérés. Ses qualités ? Sobriété des demandes. Et le général de Castries, témoin de l’exploit de Tokyo, d’ajouter :
– Si l’expression « unis corps et âme » a un sens, le parcours de Jonquères et de Lutteur en a été l’illustration parfaite. Rarement équilibre unique du cavalier et du cheval peut être ainsi atteint. C’était de l’art simple, mais du grand art.
On ne pratique pas le jumping devant un miroir.
Dans À cheval sur cinq olympiades , pp. 203-204, Jonquères, puisque c’est officiellement lui qui écrit, a cette explication sur sa propre équitation : « On m’a cent mille fois questionné sur ma manière de monter. On m’a écrit de partout pour me demander une foule de précisions à ce sujet.
Or, je ne me vois jamais en action pour la simple raison qu’on ne pratique pas le jumping devant un miroir. Les danseurs et les boxeurs, eux, peuvent s’entraîner ainsi et corriger leurs défauts ». Avec cette explication préalable qui aujourd’hui ne serait pas recevable, dans la mesure où le caméscope et la vidéo ont changé la donne, il botte astucieusement en touche. Fausse pudeur ? « Je passe la parole à ceux qui m’ont souvent vu monter en concours, des hommes de cheval et de compétition dont la gentillesse me trouble un peu mais qui savent tout de même de quoi ils parlent. »
Et « l’auteur » de reprendre intégralement la citation de Christian de Castries, telle que reprise du d’ Oriola d’Albaret publiée plus haut… Il fait ensuite intervenir Georges Calmon qui fut l’un de ses coéquipiers en équipe de France. Ce dernier insiste sur « le sens de l’abord » poussé à un degré rare. Il sent la foulée à quinze mètres au moins de l’obstacle et, quand il l’a, il ne lui reste plus qu’à attaquer en foulées longues. » On retiendra un jugement inédit proféré un peu plus loin : « De plus, et bien que la sobriété de ses gestes n’en laisse rien paraître, Pierrot est un utilisateur extrêmement énergique. C’est un athlète vrai. ». C‘est au commandant Cavaillé, l’ami de toujours, le « tacticien » d’Helsinki, que reviendra le mot de la fin sur la question de « l’équitation de d’Oriola » : « Jonquères répond à l’essentiel de ce que l’on peut exiger d’un cavalier de classe internationale : valeur athlétique et professionnelle, science de la monte, vigueur, tempérament, bonne santé, sens des possibilités et de l’emploi, aptitude enfin, aux servitudes du métier. »
Pour finir sur ce chapitre, disons que le livre d’Elsa Romero n’apporte que peu de nouveaux éléments. On notera toutefois, p. 68, ces deux paragraphes : « Obtenir la simplicité dans un sport par essence compliqué doit être l’objectif suprême du cavalier. La relation avec le cheval doit être la plus pure possible. » Aussi ne serons-nous pas étonnés, de lire sur la même page ce tacle à l’adresse des cavaliers qui usent et abusent des enrênements : « J’ai remarqué que, plus il y avait de ficelles, plus les gens étaient contents, peut-être parce que le fait d’avoir transformé leur cheval en une sorte de bateau leur donne l’impression d’être plus intelligents que les autres. »
Cette équitation dite « naturelle », instinctive, libre fait sans doute sourire aujourd’hui où la compétition peut apparaître plus sévère qu’à l’époque. Est-ce bien sûr ? La sélection du cheval de sport et de jumping a bien évolué, facilitant l’exercice. Et les parcours plus normalisés, formatés, ne le rendent-ils pas moins imprévisible ? Le talent du cavalier ne relevait-il pas, il y a cinquante ans, de la capacité d’adaptation de réaction, d’improvisation devant des obstacles, souvent plus variés, où la terre (butte, talus) et l’eau (bidets, brooks, ruisseaux) étaient souvent au programme ? Au fond, le but n’était-il pas davantage de tester, de mesurer clairement le degré de connivence, de confiance du couple cavalier-cheval devant l’imprévu, que la répétition de l’exercice du couple, de la « programmation » à laquelle on assiste aujourd’hui ? Une évolution que d’Oriola, comme bien d’autres déplorait, contestait.
Sempre endavant
À chaque époque, ses paramètres. Ce qui ne change pas, c’est le comportement de l’homme face aux épreuves : celles de la vie et/ou donc du sport. Alors, il se révèle, comme le cavalier face à l’obstacle ; en toute circonstance, surtout face à lui-même.
Le caractère ! Oui, au fond, comme nous avons pu le vérifier de manière anodine le 28 octobre 1999 à Perpignan, nous arrivons à la même conclusion qu’Albaret qui a « pratiqué » le champion plus de trente années durant. Ce qui tranchait chez d’Oriola, c’était le caractère. Celui qu’ont pu connaître ses contemporains, ses adversaires, mais osons ici l’affirmer au risque de faire sourire : le caractère qu’ont entendu, senti, apprécié les chevaux avec lequel il a mené son et ses parcours !
D’Oriola oui, un caractère à l’image de son terroir. Catalan ! Sempre endavant (Toujours devant) !
Tout d’abord attachant, car tous ceux qui ont côtoyé Pierre Jonquères d’Oriola à commencer par les familiers de Corneilla, son fidèle premier garçon d’écurie, Jean-Claude Gautier, son maréchal ferrant Fernand Llovera et tant d’autres jusqu’à ses adversaires lors des compétitions étaient d’abord des amis. Pierrot était aussi attachant qu’il pouvait se détacher !
Car la rectitude du sillon d’une vie, d’un alignement de ceps, n’empêche pas la fantaisie, la plaisanterie, la convivialité.
En ouverture de cette étude, nous avions esquissé comme d’ailleurs dans l’interview réalisée pour L’Éperon en 1999, ce parallèle entre Pierre Jonquères d’Oriola et Éric Tabarly.
Peut-être parce que tous les deux ont réalisé leurs exploits en cette même année 1964. Tabarly y bat le record du tour du monde en solitaire à la voile, la fameuse OSTAR anglaise (the Original Singlehanded TransAtlantic Race). C’est énorme et les retombées médiatiques également. Le vainqueur est évidemment heureux mais affiche une réserve qui sera son image de marque et contribuera à sa légende. Dans la foulée, trois mois plus tard, et dans un registre totalement différent Pierre Jonquères d’Oriola réussit le premier doublé olympique (inégalé jusqu’à nos jours). Et sans avoir la réputation de granit de Tabarly, d’Oriola est tout aussi solide face à la notoriété, et entre à son tour dans la légende de son sport.
D’Oriola et la correspondance…
On l’a vu dans l’étude commentée, d’Orgeix et d’Oriola ont eu des parcours parallèles et une relation d’homme et de sportif où alternèrent les moments « avec », les plus nombreux et les moments « sans ».
En voici quelques preuves.
On commencera par la genèse telle que la décrit d’Oriola dans le premier chapitre de À cheval sur cinq olympiades . Nous sommes en 1946, les concours viennent de reprendre et les deux jeunes hommes sont les premiers civils à pouvoir rivaliser — s’imposer — face aux cavaliers militaires qui composaient quasi uniquement l’équipe de France jusque-là. « Chez nous, la guerre avait prématurément vieilli les talents et provoqué de nombreux renoncements. C’est pourquoi Jean d’Orgeix et moi formions la relève. Nous étions « la nouvelle vague » selon une expression qui allait faire fureur… vingt ans plus tard ! D’Orgeix, le Paqui du théâtre Daunou, bouillait de tout l’enthousiasme qu’on peut avoir à vingt-cinq ans. Et moi, son aîné d’un an, j’avais la fougue d’un pur-sang. Paqui était comme moi fils de grand cavalier. Il avait hérité de Sucre de Pomme, un petit cheval au cœur gros comme ça qu’il adorait.
Et moi j’avais L’Historiette que mon père m’avait offerte avant de mourir ».
Ce rappel effectué, on peut bien imaginer qu’étant tantôt « équipiers » parfois adversaires, les deux hommes issus de milieux comparables qui sont partis dans la vie, à peu de choses près, en même temps (d’Orgeix en 2006 et d’Oriola en 2010) ont échangé toute leur existence durant. Et prétendre qu’en vieillissant, ils ont toujours été du même avis sur l’évolution du sport serait inexact.
À défaut de « publier » comme l’a fait d’Orgeix auteur de plus d’une dizaine d’ouvrages, d’Oriola s’est contenté de « correspondre ».
Impossible de faire l’état de toute cette correspondance. Piochons, picorons dans la documentation amassée par Roger-Louis Thomas l’éditeur de L’Information Hippique de 1956 à 1982. D’accord ici, pas d’accord là le d’Oriola… Lanceur d’alerte si nécessaire, comme en 1963 (Lettre 1), un an avant sa médaille d’or de Tokyo. Déjà, il est inquiet. Lutteur n’a pas encore intégré son « piquet ».
Quelques années plus tard, il règle ses comptes avec le commandant Gudin de Vallerin, comme par exemple en 1966 après son succès dans le Mondial de Buenos Aires (Lettres 2). Le militaire est agacé par ce qu’il considère être de la suffisance de la part du nouveau champion du monde. En 1966, Gudin qui est né en 1897, a près de soixante-dix ans et même s’il a participé à la finale tournante du dernier championnat de France en 1956, et qu’il fut un grand cavalier avant-guerre (participation à 30 Coupe des Nations de 1926 à 1948, 6 e en individuel aux J.O. de Berlin en 1936, ex-aequo avec Xavier Bizard), il est d’une autre génération pour d’Oriola qui n’accepte pas la critique. La riposte de d’Oriola est aussi vive que l’attaque !
En 1974, c’est une déclaration de d’Oriola publiée dans le Journal de Genève , qui met le feu aux poudres (l’ Information Hippique et Lettres 3). Interviewé le 14 novembre, entre autres soucis, le champion déplore qu’il soit difficile de trouver de bons chevaux en France « l’élevage français est en baisse »… D’Orgeix, son vieil ami, vient d’être nommé entraîneur de l’équipe de France de Saut d’obstacles et s’insurge, dans la même gazette, cinq jours plus tard : « Jonquères d’Oriola serait encore capable de remporter une très grande victoire car il a son génie, mais il n’a plus vingt ans… Au lieu de l’admettre, c’est probablement son orgueil Catalan qui l’en empêche. Il clame partout qu’il ne peut pas courir car il n’y a plus de bons chevaux en France. » Et d’Orgeix de rappeler que le jour ou d’Oriola avait fait cette déclaration, deux cavaliers français montant les anciens chevaux confiés à d’Oriola avant les J.O. de Munich (1972), s’étaient classés respectivement premier (Hubert Parot avec Moët et Chandon) et second (Marcel Rozier avec Tournebride LA), dans une épreuve du jumping Genevois.
Évidemment, le Catalan a pris la mouche et la plume.
Mais le moins que l’on puisse dire, et l’on en voudra pour preuve le dernier courrier de sa part publié dans l’ Éperon en mai 2005 (L’Éperon et lettre 4), soit un an avant la disparition de Paqui, c’est qu’il n’est pas rancunier. D’Orgeix est, et restera son ami, pour toujours.
En savoir plus :
- Fiches des livres sur d’Oriola
- Portefolio
- Les d’Oriola et les vendanges olympiques, Fernand Albaret (Paris, La Table Ronde, 1965)
- Pierre Jonquères d’Oriola, Fernand Albaret (Paris, Librairie des Champs-Élysées, 1965)
- À cheval sur cinq olympiades, Pierre Jonquères d’Oriola(Paris, Raoul Solar, 1968)
- Équitation naturelle, Elsa Romero (Canet, Trabucaire, 2008)
Articles champion portrait saut d'obstacles Études commentées